Le Pont des Contrebandiers, le Val Muggio et le Val d'Intelvi
- Karin

- 13 juin 2025
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 14 juin 2025
Aujourd’hui, promenade italo-suisse.
Direction le village d’Erbonne, au pied du Monte Generoso, là où la Vallée d’Intelvi côtoie celle de Muggio.
Facile à dire. La route serpente, les virages en épingle s’enchainent, la chaussée se rétrécit à flanc de précipice. Pas de garde-fou. Juste des arbres.
On traverse le village de Casasco en priant pour nos rétroviseurs. Ma hantise est de me retrouver coincée entre deux maisons. Chaque habitant risque sa vie en sortant de chez lui. Et pour croiser un autre véhicule ? Peut-être que c’est un sens unique et qu’on n’a pas vu le panneau. Ou peut-être qu’il n’y en a pas.
La route sort de la forêt sur le Piano delle Alpi et un beau panorama. Il vaudrait la peine de s’y arrêter pour faire trois pas mais à ce stade-là de l’aventure, je n’ai qu’une envie: arriver au plus vite à notre point de chute.
Erbonne, fin de la route. Fin du monde.
Cinq habitants. Pour aller chez le dentiste, il faut vraiment avoir très mal. L’auberge est à vendre, l’école sous échafaudages, mais on devine qu’il n’y a plus d’enfants depuis longtemps. Ce hameau entièrement construit en pierres, autrefois simple alpage d’été utilisé par les agriculteurs de la Valle di Muggio, s’est pourtant développé et a connu une vie plus animée : jusqu’à 160 âmes et 200 vaches y ont résidé à l’année. Les produits laitiers et agricoles étaient transportés en Suisse à dos d’homme. La plupart des habitants étaient de nationalité helvétique mais dans ces contrées dont les origines remontent à la préhistoire, les frontières n’ont longtemps pas existé. Celles-ci ne furent officiellement tracées qu’en 1752 et dès lors les conflits administratifs s’en mêlèrent. Chaque commune voulait sa part d’impôts tandis que les habitants d’Erbonne, privés de route carrossable et d’électricité jusqu’à une époque récente, avaient surtout l’impression d’être oubliés de tous.
En 1944, le régime fasciste déclara la zone « fermée » : tout village ou maison dans un rayon de trois kilomètres de la frontière devait être évacué. Une grande partie des résidents suisses se rendit au Tessin. Les récalcitrants furent déplacés ou se réfugièrent dans des fermes d’alpage.
Les décennies ont passé mais l’absurdité administrative, elle, est restée : en 2000, l’Europe a jugé que les Erbonesi, pourtant installés là depuis des siècles, étaient des « ressortissants de pays tiers en situation irrégulière ». Ils ont dû faire la queue à la préfecture de Côme pour obtenir un permis de séjour.
En 2015 il ne restait que neuf habitants, tous des anciens, et deux vaches. L’école, elle, avait fermé dans les années 1970.
Et sur la petite place du village, cela faisait longtemps qu’on n’y dansait plus.
À l’époque, les habitants rejoignaient la Suisse en descendant dans le lit de la rivière Breggia pour remonter sur le village de Scudellate. Aujourd’hui, nous empruntons le Pont des Contrebandiers, un ouvrage inauguré en 2005 et qui remplace l’ancien situé en contrebas. En plus d’être piéton, le pont est cyclable. En le franchissant, j’aurai une pensée émue pour les habitants d’autrefois, coriaces et tenaces, qui arpentaient les coteaux sans craindre néanmoins de prendre un VTT en pleine face.

Nous voici désormais en Suisse avec tous nos papiers en règle, comme le demande la pancarte, et pas plus de marchandises que notre pique-nique. Chose qu’il vaut mieux prévoir en ces régions sauvages. Un petit sentier longe les versants escarpés dans une belle forêt de hêtres. Arrivés auprès d’une chapelle, nous sortons des bois en ayant une échappée sur le village d’Erbonne au loin. Nous traversons des champs, croisons des ânes, dépassons quelques rustici et atteignons Scudellate en une demi-heure.
Le village est vite traversé. Il y subsiste néanmoins une auberge qui semble être le point de ralliement des cyclistes. Dont un qui s’écrie en faisant allusion à leur montée jusqu’ici:
-Plus jamais ça !
Bon.
Ça en fera un de moins.
Depuis les magnifiques anciens lavoirs de Scudellate, nous revenons en arrière en empruntant un sentier muletier qui traverse des près peuplés de chevrettes noires. Nous dépassons un refuge de montagne bien restauré et arrivons ainsi au roccolo, soit une tour de pierres sèches destinée autrefois à capturer les oiseaux.
Ici, nous avions décidé de nous arrêter pour pique-niquer mais nous allons devoir composer avec Marcello. La soixantaine bien tassée, ce monsieur n’a rien trouvé de mieux en ce lundi de Pentecôte, que de ratisser la forêt devant la tour. Il ne doit pas avoir la télé. Il rassemble feuilles et branchages et les balance dans le talus, en direction du sentier. Sur son pantalon orange de chantier, je n'ai rien à dire, mais son pull est déchiré de partout. On lui voit les bras, les épaules et sa bedaine bringuebalante. Autant rien mettre. Ou un marcel. Nous nous installons sur le seul petit bout d’herbe au soleil et c’est pile là que Marcello a envie de ratisser maintenant. Réfugiés alors sur les marches du roccolo, nous expédions notre pause et reprenons le sentier qui serpente au milieu des hêtres, surveillant que l’autre ne nous jette pas son tas de branchages sur la tête.
Nous rejoignons notre tracé initial et franchissons à nouveau le pont des contrebandiers. En passant devant l’église, j’en profite pour préciser qu’elle a été construite dès 1922 avec la sueur et les sous des Erbonesi. Jusqu’alors, il fallait aller à Scudellate pour les messes et les mariages, ainsi que pour y enterrer ses morts.
Sur la placette, l’habitante numéro 1 va jeter ses détritus dans les containers et discute avec l’habitant numéro 4.
À noter encore qu'une petite bâtisse de pierres a été reconvertie en musée miniature de la contrebande. Elle se trouve dans un champ à l'écart du village. Nous n'y sommes pas allés, d'une part car nous devons économiser nos pas, d'autre part car toute une famille de promeneurs s'y rendait. Et le site est vraiment minuscule.
Nous reprenons la même route, enchaînant à nouveau les virages, les talus sans barrières, et retrouvons sans surprise Casasco. Qui est bien, comme on le soupçonnait, en partie à sens unique. Cette fois, il faut passer sous une étroite arcade, tourner sec à gauche en évitant les murs, les boîtes aux lettres, les escaliers, les poules. Ah non, pas les poules.
Comme notre retour dans le Val d’Intelvi ne semble pas imminent, autant en profiter encore un peu. Prochaine étape: la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.
Là encore, ce qui semble simple sur la carte se complique sur le terrain. Notre GPS s’obstine à vouloir nous faire traverser des ruelles plus adaptées aux ânes. J’aurais mieux fait de garder ma Fiat Panda. Finalement, nous abandonnons sagement notre véhicule sur la petite place de Scaria. Quinze minutes à pieds et nous serons fixés.
La balade n’est pas exceptionnelle mais l’arrivée sur l’église en vaut la peine. Les origines de l’édifice remontent au XIIe siècle et son décor pictural, daté des XVIe et XVIIe siècles, témoigne d’un raffinement inattendu dans ce recoin montagnard. Hélas, l’église est fermée mais une fenêtre grillagée laisse entrevoir une superbe fresque et des travaux en cours. Et son portique latéral voûté est richement décoré.
Comme souvent, ici, le passé survit dans un demi-sommeil.
Dernier crochet avant de redescendre en plaine: le belvédère de Lanzo d’Intelvi au pied de l’hôtel Funicolare.
« Au début du XXe siècle et jusqu’aux années 1970, la bourgade était considérée comme un lieu prestigieux par l'aristocratie milanaise et les familles juives, notamment grâce à la liaison directe avec la ville de Lugano assurée par un funiculaire, aujourd'hui désaffecté mais sur le point d'être réactivé,* qui menait aux rives du lac et, par bateau, à la ville de Lugano. »
*LOL, sources Wikipédia
Le funiculaire tombe en ruines. En contre-bas, on accédait au hameau de Santa Margherita, aujourd’hui abandonné et accessible uniquement par bateau privé. L’hôtel Funicolario, par contre, a rouvert depuis peu après avoir été fermé des années. Le bâtiment garde une certaine prestance, même si la discothèque et la gelateria attenantes semblent figées dans la poussière. Un peu plus loin, les belles demeures Art nouveau ont pour la plupart les volets clos.
La vue, d’ordinaire splendide, est ce jour-là voilée d’une brume étrange, due paraît-il aux incendies du Canada. Le Ceresio se devine à peine dans cette lumière laiteuse.

Par temps clair et pour les plus vaillants, on peut pousser un peu plus loin, direction le Sighignola et le lieu-dit « Balcon d’Italie ». Sept kilomètres de virages supplémentaires mais largement récompensés par un panorama spectaculaire sur les Alpes et le lac en contrebas. Un dernier souffle d’altitude avant de redescendre dans le monde ordinaire.
Photos février 2022
Sources :
Panneaux didactiques
La Nostra Storia : Erbonne, un paese dalla doppia identità
La Nostra Storia : Lo strano caso del paese di Erbonne
et Wikipédia...
Komoot pour les cartes
Détails et plan de la promenade























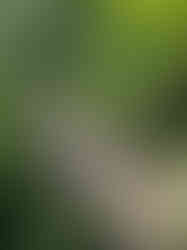









































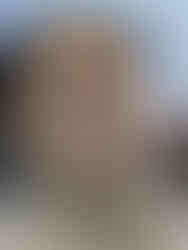








































Commentaires